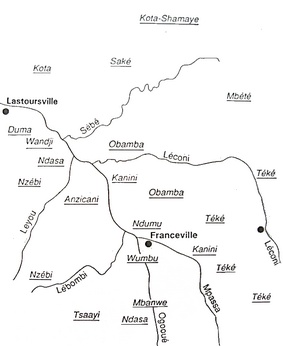Le
Haut-Ogooué, région
clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,
est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa
capitale Franceville ayant été fondée
dès 1880 par Savorgnan de Brazza.
Le
Haut-Ogooué, région
clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,
est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa
capitale Franceville ayant été fondée
dès 1880 par Savorgnan de Brazza.
Cet
article a été écrit par Louis Perrois,
de l'IRD (ex-Orstom), et publié dans la revue d'entreprise
Electrons de la SEEG (numéro 8, décembre 72).
Plan
de la rubrique :
 |
LE
BLASON
De sable à deux pioches d'or posées en sautoir et
accompagnées de quatre carreaux d'argent posés en
losange, au chef d'or semé de grains de café de
sable posés en pal.
Les richesses minières de la région et leur
exploitation sont symbolisées par la couleur "de sable",
c'est-à-dire noire, du champ de l'écu (les
entrailles de la terre), par les pioches et par les "carreaux d'argent"
représentant les blocs de minerai. Les gisements
aurifères sont évoqués par le
métal "d'or" du chef. Les grains de café font
allusion à cette importante production de la region.
|
HISTOIRE
Haut
Les gisements préhistoriques découverts dans le
Haut-Ogooué attestent une présence humaine
très ancienne remontant certainement au
paléolithique. Il est certain que depuis des
millénaires, la région est une zone de passage du
seul fait de son emplacecement géographique
particulièrement favorable à des
déplacements entre le Moyen et le Haut-Ogooué et
l'Ogooué, l'Ogooué et I'Alima vers le Congo.
Brazza s'en rendit compte dès qu'il eût atteint
des savanes du pays ndoumou et ndassa en 1880, lors de sa seconde
expédition. Franceville, dont le nom originel est Masoukou,
fut d'abord appelé Francheville par Brazza. Celui-ci fut
bloqué par les chutes de Poubara et décida
d'orienter ses recherches ultérieures vers le nord-est,
d'une part vers la Licona, d'autre part vers I'Alima par la piste des
Batéké.
C. COQUERY décrit ainsi la situation du poste entre 1880 et
1886 :
« La grande station demeurait, à huit jours en
amont, après un seul mauvais passage (le rapide de
Doumé), Franceville. Cette station de transit et de
transbordement était établie au bord de la Passa,
affluent de droite de l'Ogooué, à la jonction
entre la voie fluviale et la piste de terre qui conduisait à
I'Alima. A l'arrivée de la Mission, quelques baraquements
servaient d'entrepôts à Ballay; dès
I'été 1883, quatre Européens, cinq
laptots et dix Kroumen y étaient installés. Les
deux premières années furent difficiles ; les
méthodes autoritaires du chef de poste, Thollon,
assisté d'un matelot « ivrogne et
débauché »,
éloignèrent les habitants. A partir
d'août 1884, le brigadier Roche entreprit d'achever la piste
ouverte par Joseph Michaud en 1881 ; l'année suivante, on
transféra le poste de la rive droite à la rive
gauche de la rivière, car « bien que la station
fût placée sur une hauteur et dans une position
relativement salubre, elle avait le grand inconvénient
d'être séparée de la route des
Batékés par la rivière Passa. A chaque
convoi, il y avait une perte de temps très grande pour faire
passer les porteurs, à l'arrivée et au
départ (...). Le passage de certains convois a
demandé plus de deux jours ». (Pradier, op. cit).
« En 1886, Franceville comptait deux magasins de 30
mètres chacun, une grande case d'habitation (27 m), un
magasin de détail et, à 150 mètres de
là, un village réservé au personnel
africain ».
L'installation des postes européens sur l'Ogooué,
de Lambaréné à Booué,
Madiville (Lastoursville ensuite) et Franceville, permit au commerce de
se développer depuis le Haut-Ogooué jusqu'au Cap
Lopez et les zones côtières de Libreville, en
brisant les monopoles des différentes ethnies
(Okandé, Ossyéba, Adouma) qui
contrôlaient le trafic du fleuve.
UN
RICHE PASSE
Haut
Mais comme partout en Afrique noire, il faut savoir que l'Histoire
proprement dite commence dès avant la
pénétration des explorateurs
européens, bien que ses péripéties en
soient plus conjoncturelles.
Les peuples de la vallée de l'Ogooué ne sont pas
originaires des régions où on les trouve
actuellement. Un vaste mouvement de migration, commencé il y
a des siècles, s'est accentué aux
XVllème et XVlllème siècles dans une
direction nord-sud pour la masse Kota et est-ouest pour les
Batéké jusqu'à la limite de la
forêt.
Les Kota, parmi lesquels il faut distinguer les Bakota du nord et les
Obamba du sud, se sont acheminés vers le
Haut-Ogooué à partir de la Sangha dès
le XVllème siècle. Des groupes sont
restés en route sur I'lvindo, d'autres sont
passés par le Congo, les Obamba, certains sont descendus
très au sud jusqu'aux sources de l'Ogooué, les
Mindassa et les Bawoumbou.
Actuellement, on peut distinguer les Bakota du nord
patrilinéaires des Obamba du sud matrilinéaires,
Certains étant apparentés aux
Batéké avec lesquels ils eurent souvent
à combattre et à commencer.
Les Bandzabi sont venus de l'est, avec les Batsangui qu'on trouve
aujourd'hui vers Bakoumba. Les cultures kota et ndzabi sont encore
apparentées par certains rituels, tels la circoncision. Le
problème de leur lointaine origine commune se pose, bien que
les dialectes soient très différents.
Par contre, les Batéké, les hommes des plateaux,
sont de culture et de mentalité différentes, avec
des villages fortement organisés qui ont
impressionné les premiers explorateurs.
COUTUMES
ET CULTURE
Haut
Schématiquement
le Haut-Ogooué, au folklore riche
et vivant, relève de trois cultures ethniques
différentes, Obamba, Ndzabi et Téké
avec à la fois des variantes notables et des points de
convergence, surtout en ce qui concerne les structures sociales et les
croyances essentielles.
Vers Okondja, coeur du pays Obamba, le culte des ancêtres
existait jusqu'au début du XXème
siècle. Les reliques des ancêtres
étaient conservées dans des paniers
surmontés de figurines sculptées recouvertes de
feuilles de cuivre dont certaines sont des chefs-d'oeuvre de l'art
africain traditionnel.
De filiation matrilinéaire, la société
obamba était organisée en tillages qui
regroupaient un certain nombre de clans. Les forgerons travaillaient le
fer pour en façonner des outils et des armes. Le cuivre
importé dès le XVlème
siècle par les tribus côtières, servait
à faire des bijoux dont certains étaient
utilisés comme monnaie de dot. Les
activités agricoles limitées aux
cultures vivrières (maïs, manioc, bananes)
étaient dévolues aux femmes qui laissaient
aux hommes le temps de pêcher et surtout de
chasser. L'art de tisser le raphia vint du pays
batéké vers la fin du XlXème
siècle.
Plusieurs sociétés à
caractère initiatique animaient la vie sociale ancienne de
ces villages en perpétuel déplacement. Les
grandes fêtes de la circoncision accompagnées des
rites de passage de la puberté permettaient
aux « nganga
» d'étaler leur habileté, leur savoir
et leur sens
de la danse.
Actuellement la plupart de ces danses à caractère
sacré ou social sont devenues des danses de divertissement,
masquées ou non.
Les Bandzabi, établis plus à l'ouest,
présentent à peu de choses près les
mêmes caractéristiques culturelles : culte des
ancêtres, sociétés initiatiques,
croyance à l'esprit du « Mungala »
(grand masque figurant un monstre aquatique), « anarchie
» structurelle des villages où chaque
aîné de lignage était un chef,
agriculture de subsistance, pêche et chasse à la
sagaie, au harpon et au filet (comme les Pygmées qui furent
leurs initiateurs en matière de chasse et de cueillette). |
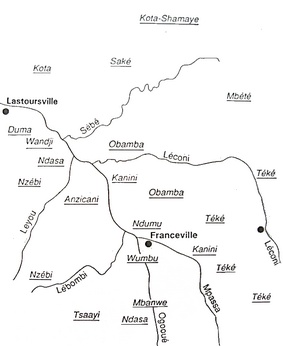
Les peuples du
Haut-Ogooué,
d'après le docteur Miletto |
Les Batéké des plateaux, isolés dans
les vastes vallonnements rases et sablonneux des confins de la
Léconi vers I'Alima, vivaient en gros villages dont
l'activité principale a toujours été
le commerce. De longues caravanes se rendaient en pays balali
à l'ouest vers le Niari, d'autres vers I'Alima à
l'est. Les Batéké cultivaient autrefois le mil
puis le manioc qui suscita un volume d'échange
considérable avec leurs voisins. Ils fabriquaient en outre
des pagnes de raphia et travaillaient le fer.
Les chefs teké avaient pour emblème une peau de
panthère, une cloche double, une queue de buffle et une
canne ornée de cuivre.
Dans toute la région, depuis des siècles, les
migrations des différentes tribus, de chaque clan et
même village provoquèrent des affrontements
continuels. La guerre était une des principales
activités des hommes.
Les rituels propitiatoires à caractère
initiatique avaient surtout pour but de protéger les
initiés des dangers de la vie de brousse (famine, guerre,
chasse, etc ... ) Les masques servaient en
général à inspirer une crainte
respectueuse aux femmes, enfants et non initiés;
c'était un élément de
régulation sociale.
Aujourd'hui, il ne reste de ces coutumes que des bribes, certaines
habitudes sociales et familiales (relations d'autorité,
circuits matrimoniaux), techniques (agriculture, artisanat du fer et du
raphia) et artistiques (musique, chants et danses).
Comme partout au Gabon, c'est la musique, la danse et la
littérature orale, très riches dans toutes les
ethnies du Haut-Ogooué, qui subsistent malgré le
modernisme de la vie quotidienne
contemporaine des altogovéens.
LE
HAUT – OGOOUE AUJOURD’HUI
Haut
Région au développement fulgurant depuis la mise
en exploitation des gisements de manganèse et d'uranium, le
Haut-0gooué a subi ces dernières
années une transformation sociale notable : des villes
industrielles sont nées (Moanda, Mounana). Franceville est
devenue une capitale régionale animée ; la
population s'est regroupée et a augmenté
très sensiblement; les courants d'échanges se
sont multipliés grâce aux voies de communication
améliorées et praticables d'une
manière permanente. On assiste à un brassage
continu des ethnies, non seulement du Haut-Ogooué, mais de
tout le Gabon.
Les coutumes ancestrales s'estompent au profit d'un mode de vie de type
semi-urbain qui, moins attrayant sur le plan culturel et folklorique,
est évidemment plus conforme aux exigences actuelles du
développement national.
 Le
Haut-Ogooué, région
clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,
est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa
capitale Franceville ayant été fondée
dès 1880 par Savorgnan de Brazza.
Le
Haut-Ogooué, région
clef du Gabon d'aujourd'hui de par ses ressources minières,
est également un des hauts lieux de l'histoire gabonaise, sa
capitale Franceville ayant été fondée
dès 1880 par Savorgnan de Brazza.